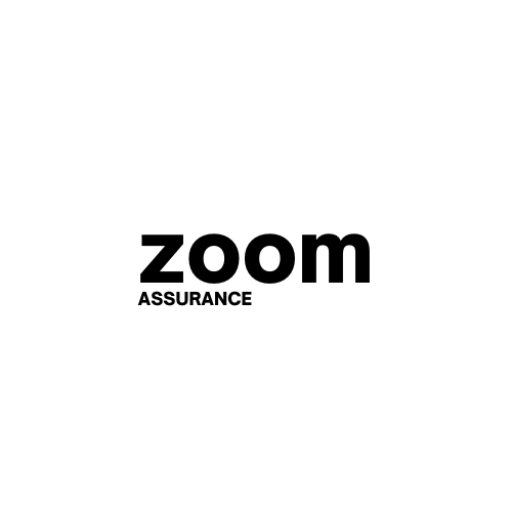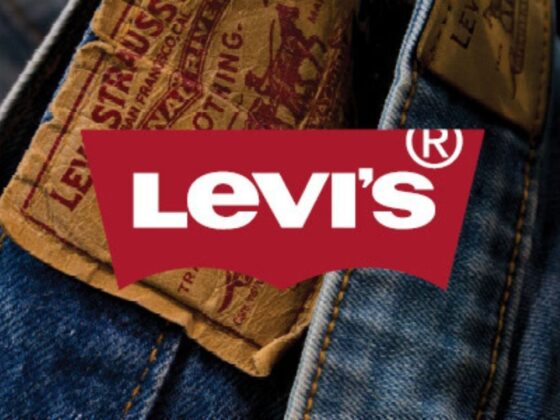Alors que 6,4 millions de Français n’ont pas de médecin traitant, certaines régions misent sur le salariat des médecins pour combler les déserts médicaux. Une décision qui séduit, mais ne fait pas l’unanimité. En septembre, le gouvernement de François Bayrou proposait un dispositif inédit : le déploiement de médecins volontaires qui viendraient assurer jusqu’à deux jours de consultations mensuelles dans les déserts médicaux. Au total, 151 communes prioritaires ont été identifiées. Car l’urgence est telle qu’aujourd’hui, 87 % du territoire est classé en désert médical. La situation ne devrait pas s’améliorer de sitôt, alors que la population française vieillit et que le nombre d’heures d’activité par médecin diminue. Pour attirer ces derniers, tous les moyens sont bons. Certaines régions ou collectivités ont ainsi fait le choix de salarier leurs médecins généralistes, voire d’autres professionnels de santé.
Le modèle du salariat médical
C’est le cas, par exemple, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur son site internet, on compte huit fiches de postes pour des médecins, un poste de sage-femme ainsi que trois postes d’infirmières. Les professionnels de santé sont employés pour un contrat de 3 ans, renouvelable une seule fois et bénéficient de nombreux avantages supplémentaires par rapport aux médecins libéraux. Parmi eux, la présence d’un secrétariat médical pour les tâches administratives, un véhicule professionnel ainsi qu’un salaire entre 4.000 euros et 6.000 euros net. Ce qui change surtout, c’est le temps de travail de 35 heures par semaine pour un temps plein, soit plus que les 54 heures de temps moyen d’un médecin libéral.
Un service rendu aux habitants
La région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que l’Occitanie ont suivi le modèle de la pionnière en la matière : la région Centre-Val-de-Loire, dont la stratégie salariale est opérationnelle depuis 2023. Deux ans après, elle semble porter ses fruits à un tiers du parcours. 70 médecins, en majorité des généralistes, sont désormais installés au sein de 20 pôles de santé à l’échelle du territoire. Ils sont basés dans des zones rurales comme à Ferrières-en-Gâtinais dans le Loiret, ou dans des quartiers urbains difficiles à l’instar des Rives du Cher à Tours.
Des résultats ambitieux attendus
Frédéric Valletoux, président de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, a déclaré : « Nous nous sommes fixé un objectif de 150 médecins salariés à mi-étape en 2028 ». Même si c’est ambitieux, nous espérons encore doubler ce chiffre dans cinq ans. Dans les faits, les profils cibles sont variés. Ils vont des jeunes diplômés souhaitant acquérir une expérience avant de s’installer en libéral, aux médecins en fin de carrière qui veulent se concentrer seulement sur les actes médicaux. Des professionnels retraités peuvent aussi saisir l’opportunité d’un revenu complémentaire. Reste la question du financement, assuré par la région via le GIP Pro santé, situé à hauteur d’un million d’euros par an (plus de deux millions d’euros la première année).
Des solutions à nuancer
Toutefois, ces mesures ne sont pas un modèle parfait. Frédéric Valletoux souligne que « un médecin salarié fait ses heures de contrat alors qu’un médecin libéral suit une patientèle ». En termes de nombre de patients suivis, cela n’a pas le même impact. Dans la sphère politique, plusieurs voix s’élèvent en faveur d’une obligation d’installation de nouveaux médecins dans les déserts médicaux. C’est ce qu’a porté le député PS Guillaume Garot via une loi transpartisane adoptée à l’Assemblée nationale en mai dernier.
Les décisions politiques en suspens
Le gouvernement de François Bayrou avait alors voulu couper l’herbe sous le pied à l’élu de gauche en proposant un pacte de lutte contre les déserts médicaux. Cependant, deux mois plus tard, les élus de gauche comme de droite ont de nouveau exhorté le gouvernement à inscrire le texte au Sénat dès que possible. Depuis, deux Premier ministres ont claqué la porte et le sujet reste en suspens.
À lire aussi : d’autres articles sur le même sujet.